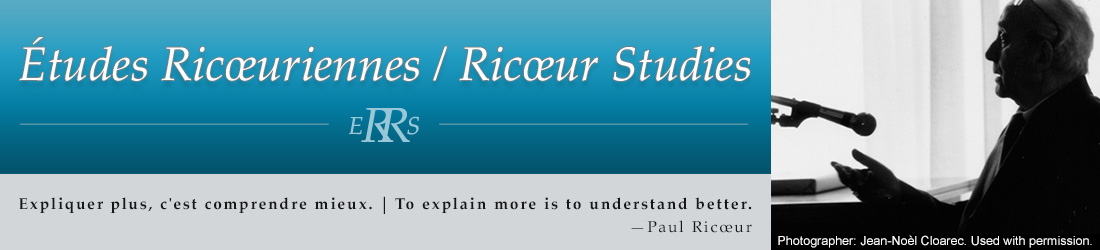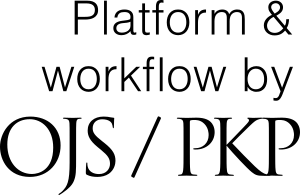ERRS Appel à propositions / Call for papers - ERRS, Volume 16, n° 2 (2025) : « Les défis contemporains à l'épreuve de l'herméneutique critique : perspectives ricœuriennes / Contemporary Challenges Confronted by Critical Hermeneutics: Ricœurian Perspectives
APPEL A PROPOSITIONS / CALL FOR PAPERS :
Études Ricœuriennes / Ricœur Studies (ERRS)
ERRS Volume 16 n° 2 (2025) : « LES DÉFIS CONTEMPORAINS À L’ÉPREUVE DE L’HERMÉNEUTIQUE CRITIQUE : PERSPECTIVES RICŒURIENNES »
L’intitulé de cet appel à propositions invite à engager une réflexion sur les ressources de la pensée éthique et politique de Ricœur pour faire face aux multiples défis sécuritaires, militaires, politiques, économiques, sanitaires, écologiques, sociaux et sociétaux que le monde n’a cessé de rencontrer depuis le début du XXIe siècle.
Notre pari n’est pas aisé. Même s’il existe une philosophie politique ricœurienne marquée par les sensibilités intrinsèques à sa réflexion, Ricœur ne propose pas une pensée politique systématique. Aucun de ses ouvrages n’est entièrement consacré à la politique : Lectures 1. Autour du politique (1999), Histoire et vérité (1955) ou encore Du texte à l’action (1986) sont des recueils d’articles initialement publiés dans des revues intellectuelles telles qu’Esprit ou Christianisme social, avant d’être rassemblés quelques années plus tard. En dehors de ces recueils, la pensée éthique et politique de Ricœur se trouve également exposée dans la « petite éthique » de Soi-même comme un autre(1990), dans La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) ou encore dans La critique et la conviction (1995). Au-delà des œuvres et des recueils, il faut enfin noter qu’une part substantielle de la pensée socio-politique ricœurienne se donne à lire dans des essais indépendants. Néanmoins, cette disparité reste trompeuse, car la philosophie éthique et politique de Ricœur trouve en réalité sa cohérence dans le projet même d’une herméneutique critique.
L’herméneutique critique de Ricœur fait d’abord du conflit des interprétations une dimension structurelle de sa démarche. Elle récuse d’autre part la « voie courte » d’une ontologie de la compréhension et se propose de déployer une dialectique de l’expliquer et du comprendre qui situe l’explication et la compréhension sur un unique arc herméneutique. La phase d’explication inhérente à cette herméneutique fait donc appel aux ressources analytiques et critiques des sciences humaines et sociales (qu’il s’agisse de la linguistique, de la sémantique, de la critique littéraire, de l’histoire, etc.) et elle s’appuie à titre constitutif sur une critique des idéologies. Puisque le soi ne cesse, tout au long de sa vie, de fournir des efforts pour exprimer son désir d’être, conquérir son identité, s’accepter et se faire accepter, et trouver sa place dans des communautés et dans le monde, l’herméneutique, intimement liée à notre langage et à nos capacités de réflexion, ne peut être un concept figé. Dans cette perspective, l’acte critique offre à l’herméneutique la possibilité constante d’accéder à un niveau supérieur de compréhension, notamment en ce qui concerne les présupposés idéologiques, et se donne pour vocation d’examiner les structures du pouvoir. Par conséquent, l’herméneutique critique permet d’une part, de comprendre le sens produit par un texte, un discours ou une action, et, d’autre part, de critiquer les structures et mécanismes sociaux qui sous-tendent les rapports de pouvoir.
Le cadre général de cet appel à propositions étant désormais établi, nous invitons les auteurs à soumettre leurs contributions en vue d'examiner les axes suivants :
- I) Paradoxe, tragique, événement, guerre :
Malgré toutes les tentatives visant à encadrer, à l’échelle mondiale, le recours à la force militaire depuis le début du XXe siècle, d’abord par les conventions de La Haye, puis par l’établissement de la Société des Nations, les guerres n’ont cessé de ravager le monde. Les récits de la violence du colonialisme et les retours critiques sur le passé colonial nous apprennent que la violence de la guerre n’a, hélas, jamais été un phénomène isolé. Avec la guerre en Ukraine, le retour du tragique sur le vieux continent a rappelé à nouveau aux Européens la violence oubliée de la guerre.
A travers l’évocation de cette violence dans l’histoire, nous sommes renvoyés à l’essai de Ricœur intitulé « Le paradoxe politique » (1957) et qui est sans doute le texte fondateur de sa philosophie politique. Dans ce texte, il démontre l'ambivalence entre la forme et la force dans l'instauration du pouvoir politique, conçoit l’État comme étant à la fois une manifestation du pouvoir et une visée du bien, et dévoile la violence résiduelle inhérente à l’État comme la part d’ombre de la politique. Ricœur interroge ainsi les paradoxes qui existent entre la dimension verticale et hiérarchique de la domination et la dimension horizontale et consensuelle de la vie en commun. Ce texte est une parfaite illustration de la pensée de l’événement chez Ricœur et il se conjugue avec une réflexion sur le tragique en tant que défi pour la liberté humaine.
Penser en termes de paradoxe a également guidé Ricœur dans sa perception de la guerre, abordée avec un regard empreint de drame. Bien qu'il ait toujours considéré l'injustice profonde inhérente à la guerre, il déclarait avoir été partagé entre un côté pacifiste, enraciné dans l'émotion, et une vision plus rationnelle – voire hégélienne – de la responsabilité des États et de l'emploi nécessaire de la force. Ce regard dramatique sur la réalité de la guerre se manifeste à travers ses différents écrits, notamment dans Histoire et vérité. Il est intéressant de constater que cette réflexion sur le tragique de la guerre peut nous conduire vers d'autres terrains tragiques, tels que celui des réfugiés, des déplacés, de ceux qui, exclus de leur terre, vivent la réalité de l'expulsion. On peut ainsi penser à l'article de Ricœur « La condition d'étranger » (1996) où les diverses figures de l’autre, voyageur, immigré ou refugié sont discutées ; mais aussi à son intervention prononcée au congrès de la Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture à Prague en 2000 : « Fragile identité : Respect de l’autre et identité culturelle ». Sur ces questions, on évoquera bien sûr aussi son article de 1954 : « Le socius et le prochain » ainsi que toute la pensée éthique ricœurienne autour du thème de la sollicitude.
- II) Démocratie, institution, totalitarisme et populisme :
De ses écrits marqués par le tragique de l’histoire jusqu’à ses réflexions plus spéculatives et plus tardives, notamment sur la justice sociale et l’éthique dans le débat démocratique, l’idée de paradoxe a accompagné la pensée politique de Ricœur qui a défini le projet démocratique à travers le prisme du paradoxe, comme l’ensemble des dispositions qui visent à faire prévaloir le rationnel sur l’irrationnel. Après un XXe siècle marqué par le totalitarisme, durant lequel les démocraties ont fait preuve d’une faible résistance face aux régimes totalitaires, les démocraties du XXIesiècles se trouvent désormais défiées par les vagues identitaires et populistes.
Par ailleurs, les régimes autoritaires et totalitaires subsistent encore au XXIe siècle aux quatre coins du monde. Ce phénomène, qui appelle une analyse critique, nous rappelle la méfiance que Ricœur a toujours nourrie à l’égard de toute tentative de totalisation - qu’elle soit politique ou autre -, et qui, sous couvert d’une conception particulière du bonheur, chercherait à réduire la pluralité irréductible des positions et des interprétations.
Ces problématiques méritent d’être repensées par rapport à la philosophie ricœurienne. Dans cet axe, différents textes du philosophe peuvent être convoqués : « La crise de la démocratie et la conscience chrétienne » (1947), « Politique et totalitarisme » dans La critique et la conviction (1995), « La justice, vertu et institution » (1997) ou encore « Qui est le sujet de droit ? » dans Le Juste 1 (1995).
III) Politique, éthique, économie, technique et numérique :
Ce troisième axe offre la possibilité d’élaborer un vaste champ de lecture critique des écrits éthiques et politiques de Ricœur. On peut d’emblée citer le texte « Éthique et politique »[1], publié dans Du texte à l’action, qui met en lumière, à la fois, la distinction et l’intersection opérées par Ricœur entre les dimensions éthique, politique et économique. Bien que chacune de ces sphères conserve son autonomie, elles se recoupent inévitablement. Il convient néanmoins d’y ajouter une quatrième dimension, celle de la technique et de son organisation démocratique, notamment en ce qui concerne le travail, le progrès et les défis environnementaux et d’examiner également le rapport entre l’éthique, la politique et l’économie dans notre société technologique.
Dès lors, plusieurs problématiques importantes peuvent être soulevées. Par exemple, la technique numérique, qui a démocratisé la prise de parole grâce aux intelligences génératives dans la production textuelle, tend simultanément à appauvrir la structure même du langage. De nouvelles formes de subjectivité parlante, portées par l’immédiateté, la standardisation de la parole et l’absence de distance critique, se manifestent désormais. Par ailleurs, le progrès technologique engendre également des effets pervers sur les démocraties, confrontées à des manipulations telles que les mensonges et les « fakes news ». La médiation instantanée propre au numérique a réduit la distance entre les différents phénomènes, restreignant ainsi l’espace critique. Dans ce même contexte, alors que les discours politiques se sont progressivement vidés de leur substance, l’imaginaire des démocraties modernes se trouve affecté par la standardisation et l'appauvrissement du langage politique. « Langage politique et rhétorique » est un article de Ricœur, daté de 1990 et repris dans Lectures 1. Autour du politique qui pourrait être mobilisé dans ce contexte.
Nous avons aussi évoqué ci-dessus les défis environnementaux : bien que Ricœur ne soit généralement pas considéré comme un penseur de l'écologie, les éléments de son herméneutique peuvent nous aider à penser la crise écologique contemporaine[2] et ses commentaires de Hans Jonas permettraient d’engager une réflexion sur les enjeux d’une éthique de la responsabilité. Par ailleurs, la philosophie pratique de Ricœur, constamment en confrontation avec la réalité, permet d'aborder de nombreuses problématiques éthico-politiques majeures, notamment dans les domaines du soin et de la santé. Dans Soi-même comme un autre, Ricœur offre des pistes de réflexion susceptibles de répondre aux enjeux bioéthiques et aux interrogations soulevées par l'éthique médicale, telle que la question de la fin de vie et de la législation concernant l'aide à mourir. Nous constatons aussi que divers comités d’éthiques, institués au service de la santé publique, se réfèrent souvent à la pensée de Ricœur pour réguler les technologies biologiques, médicales et celles liées aux sciences de la vie, ou pour évaluer les dangers inhérents à la production industrielle.
Il nous semble enfin qu’une question essentielle traverse le deuxième et le troisième axe de réflexion que nous avons proposés : il s’agit de l’explosion des inégalités, que ce soit en matière d’accès aux biens marchands ou non marchands, aux services, ou encore à l’emploi. Elle conduit à interroger les technologies sociales en rapport avec la question de la domination et on pourrait mobiliser, à cet égard, un article de Ricœur de 1965, « Tâches de l’éducateur politique », publié dans la revue Esprit, dans lequel l’auteur examine la technique dans l’organisation du travail et l’usage des outillages dans une « démocratie économique » où la technologie se réduit à une question économique. Cette problématique touche également aux interactions sociales et à la question du pouvoir politique, puisque l’État apparaît comme l’agent de tous les arbitrages, résultat des rivalités concurrentielles entre les prétentions sur des biens hétérogènes. La question pourrait se poser alors au sein des démocraties libérales, où les frontières déterminantes entre biens marchands et biens non marchands demeurent floues.
Pour ce numéro, nous attendons une lecture philosophique de la pensée éthique et politique de Ricœur. Les propositions devront être articulées de manière critique autour des événements et défis contemporains, plutôt que de se limiter à une simple application de la doctrine ricœurienne.
Date limite de transmission des textes : 15 septembre 2025
Nombre de caractères max. (espaces compris, notes incluses) : 50 000 caractères. Les contributions doivent être rédigées en français ou en anglais
Format : Pour les questions de style, le journal suit le Chicago Manual of Style. Voir sur le site de la Revue, la rubrique « Directives aux auteurs » : http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/about/submissions#onlineSubmissions.
Les articles qui ne respecteront pas ces contraintes éditoriales ne seront pas examinés.
Instructions aux auteurs : Pour soumettre un article, les auteurs doivent s'inscrire sur le site du Journal :http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/user/register. Les auteurs doivent suivre un parcours rapide (en cinq étapes) pour télécharger leur article sur le site. Dès réception, les auteurs reçoivent un e-mail de confirmation. Tous les articles sont soumis à une procédure d'évaluation dite à l'aveugle par des pairs.
Editrice invitée : Azadeh Thiriez-Arjangi
Jean-Luc Amalric et Ernst Wolff, co-editeurs des Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies Journal http://ricoeur.pitt.edu<http://ricoeur.pitt.edu/>
CALL FOR PAPERS / APPEL A PROPOSITIONS :
Études Ricœuriennes / Ricœur Studies (ERRS)
ERRS Volume 16, N° 2 (2025): « CONTEMPORARY CHALLENGES CONFRONTED BY CRITICAL HERMENEUTICS: RICŒURIAN PERSPECTIVES »
The title of this call for proposals invites reflection on the resources within Ricœur's ethical and political thought to address the manifold security, military, political, economic, health, ecological, social and societal challenges that have continuously confronted our world since the dawn of the 21st century.
Our wager is far from straightforward. While one can indeed discern a Ricœurian political philosophy shaped by the intrinsic sensibilities of his broader thought, Ricœur does not articulate a systematic political doctrine. None of his works is exclusively devoted to political philosophy: Lectures I: Autour du politique (1999), History and Truth (1955), and From Text to Action (1986) are compilations of essays originally published in intellectual journals such as Esprit or Christianisme social, later collected and republished. Beyond these compilations, Ricœur’s ethical and political reflection is also developed in the “little ethics” of Oneself as Another (1990), in Memory, History, Forgetting (2000), and in Critique and Conviction (1995). Moreover, a significant portion of his socio-political thought unfolds in stand-alone essays scattered throughout his corpus. Yet this apparent fragmentation is ultimately misleading: Ricœur’s ethical and political philosophy finds its coherence within the horizon of his critical hermeneutic project.
Ricœur’s critical hermeneutics establishes the conflict of interpretations as a structural feature of its philosophical trajectory. It explicitly rejects the “short route” of an ontology of understanding, advocating instead for a dialectical movement between explanation and understanding, both situated along a unified hermeneutic arc. The explanatory phase intrinsic to this hermeneutics draws upon the analytical and critical resources of the human and social sciences (whether in linguistics, semantics, literary criticism, historiography, or related fields), and is constitutively anchored in a critique of ideologies. Given that the self is perpetually engaged, throughout the course of its existence, in the effort to express its desire to be, to construct and appropriate its identity, to accept itself and be recognized, and to locate itself within communities and within the world, hermeneutics—itself intimately linked to our language and to our capacities for reflection—cannot be conceived as a static concept. From this perspective, the critical gesture enables hermeneutics to ascend to ever more reflexive levels of understanding, particularly in relation to ideological presuppositions, and assumes as one of its central tasks the interrogation of power structures. Accordingly, critical hermeneutics renders it possible, on one hand, to understand the meaning as generated by texts, discourses or actions. On the other hand, it enables the critique of social structures and mechanisms that sustain relations of power.
With the general framework of this call for proposals now established, we invite authors to submit contributions that engage with the following thematic axis:
- I) Paradox, the Tragic, the Event, War
Despite all the efforts throughout the twentieth century to regulate the use of military force on a global scale, initiated by the Hague Conventions and later institutionalized through the establishment of the League of Nations, wars have continued to leave a trail of devastation across the globe. The narratives of colonial violence, along with the critical retrospections on the colonial past, reveal that the violence of war has never been an isolated occurrence. The war in Ukraine, and with it, the return of the tragic to the European continent, has once again confronted Europeans face to face with the forgotten violence of war.
In evoking this violence in history, we are reminded of Ricœur's essay “The Political Paradox” (1957), arguably the founding text of his political philosophy. There, Ricœur demonstrates the ambivalence between form and force in the establishment of political power, conceives of the state as both a manifestation of power and a goal of the good, and reveals the residual violence inherent in the state as the shadow side of politics. In doing so, Ricœur interrogates the paradoxes that exist between the vertical, hierarchical dimension of domination and the horizontal, consensual dimension of living together. This text is a perfect illustration of Ricœur's thinking on the event and is combined with a reflection on the tragic as a challenge to human freedom.
Thinking in terms of paradox likewise guided Ricœur’s perception of war, which he approached with a gaze marked by the tragic. Although he consistently acknowledged the profound injustice inherent in war, he confessed to being torn between a pacifist disposition, rooted in emotion, and a more rational - if not explicitly Hegelian - conception of state responsibility and the necessary recourse to force. This tragic sensibility concerning the reality of war pervades his writings, notably in History and Truth. It is noteworthy that Ricœur’s reflection on the tragedy of war opens onto other tragic terrains, those of refugees, displaced persons and all who, excluded from their homeland, endure the lived experience of expulsion. This line of thought finds resonance in Ricœur’s 1996 essay “The Condition of the Foreigner,” in which he discusses the various figures of the ‘otherness’, whether the traveler, the immigrant or the refugee. It also reverberates in his address at the 2000 Congress of the International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture in Prague, entitled “Fragile Identity: Respect for the Other and Cultural Identity”. These concerns are, of course, already prefigured in his 1954 essay “The Socius and the Neighbor,” and they traverse his entire ethical philosophy—most notably in his sustained meditations on the notion of solicitude.
- II) Democracy, Institution, Totalitarianism, Populism
From his writings shaped by the tragic nature of history to his later more speculative reflections, particularly on social justice and ethics within democratic debate, the idea of paradox consistently underpins Ricœur’s political thinking. He conceives the democratic project itself through the prism of paradox, as the set of dispositions oriented toward securing the primacy of the rational over the irrational. Following a twentieth century marked by totalitarianism, during which democracies often demonstrated limited resistance to totalitarian regimes, the democracies of the twenty-first century now face new threats in the form of resurgent waves of identitarian and populist movements.
In parallel, authoritarian and totalitarian regimes persist in the 21st century across the globe. This phenomenon, which demands rigorous critical analysis, recalls Ricœur’s enduring suspicion toward any attempt at totalization—whether political or otherwise—that, under the guise of a particular conception of happiness, would seek to suppress the irreducible plurality of positions and interpretations.
These issues invite renewed interrogation through Ricœurian philosophy. Within this thematic axis, several key texts may be brought into dialogue: “The Crisis of Democracy and the Christian Conscience” (1947), “Politics and Totalitarianism” in Critique and Conviction (1995), “Justice: Virtue and Institution” (1997), and “Who is the Subject of Rights?” in The Just, Vol. 1 (1995).
III) Politics, Ethics, Economy, Technology, the Digital
This third axis invites the development of a broad field of critical reading of Ricœur's ethical and political writings. A foundational reference here is the essay “Ethics and Politics,”[3] published in From Text to Action, in which Ricœur elucidates both the distinctions and the points of intersection among the ethical, political and economic spheres. While each of these domains retains its own autonomy, they inevitably intersect one another. To these three, however, a fourth dimension must be added: that of technology and its democratic organization, particularly in relation to labor, technological progress, and environmental challenges and to examine the interrelations among ethics, politics and economics in our technological society.
This raises a number of important issues. For example, digital technologies and in particular generative artificial intelligences, while democratizing access to textual production, simultaneously tend to erode the very structures of language. New forms of speaking subjectivity are arising, characterized by immediacy, the standardization of expression, and a diminishing capacity for critical distance. Moreover, technological progress generates deleterious effects on democracies, as evidenced by the proliferation of manipulative practices such as disinformation and fake news. The instantaneous mediation proper to digital environments has collapsed distances between different phenomena, thus narrowing critical space. In this same context, as political discourse has gradually been emptied of substance, the imagination of modern democracies has been affected by the standardization and erosion of political language. Ricœur’s 1990 essay “Political Language and Rhetoric,” reprinted in Lectures I: Autour du politique / Lectures I: Around the Political, may serve as a valuable point of reference for engaging with these pressing contemporary challenges.
Although Ricœur is not conventionally situated within the canon of ecological thought, certain dimensions of his hermeneutical philosophy nevertheless provide resources for engaging with the contemporary ecological crisis[4] and his commentaries on Hans Jonas, in particular, illuminates the stakes of an ethics grounded in responsibility. Moreover, Ricœur’s practical philosophy, marked by its persistent confrontation with the demands of reality, offers a fertile framework for addressing many major ethical-political questions, especially in the domain of healthcare. In Oneself as Another, Ricœur elaborates a framework that bears directly on contemporary bioethical debates, including those concerning end-of-life decisions and the juridical regulation of assisted dying.
Furthermore, we also note that various ethics committees, particularly those concerned with public health, frequently draw upon Ricœur’s thought to regulate biological, medical and life science technologies, or to assess the dangers entailed by industrial modes of production.
It appears to us, finally, that a fundamental question traverses both the second and third axis of reflection we have proposed, namely, the explosion of inequalities, whether in terms of access to market/non-market goods and services or to employment. This situation compels us to question social media technologies in their relation to the problem of domination. In this regard, one could mobilize an article by Ricœur from 1965, “Tasks of the Political Educator,” published in Esprit, in which the author examines techniques within the organization of labor and the use of tools in an “economic democracy” where technology is reduced to an economic issue. This problem also extends to social interactions and the question of political power, insofar as the state appears as the agent of all arbitrations, the outcome of competitive rivalries between claims on heterogeneous goods. The question might thus arise within liberal democracies, where the decisive boundaries between market and non-market goods remain blurred.
For this issue, we expect a philosophical engagement with Ricœur’s ethical and political thought. Contributions should be critically articulated in relation to contemporary events and challenges, rather than confined to a mere application of Ricœurian doctrine.
Closing date for the submission of texts: 15th of September 2025.
Maximum number of characters (including spaces and notes): 50,000. Articles can be written in either English or French.
Format and style: The journal follows the Chicago Manual of Style. See the rubric ‘Author Guidelines’ on the journal’s website:
http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/about/submissions#onlineSubmissions
The editors cannot consider articles that do not follow these guidelines.
Instructions to authors: In order to submit an article, authors need to register on the journal website: http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/user/register. There is a quick, five-step procedure to upload articles to the website. As soon as articles are uploaded, authors will receive a confirmation email. All articles will be peer-reviewed by two referees in a ‘double blind’ process.
Guest editor: Azadeh Thiriez-Arjangi
Ernst Wolff and Jean-Luc Amalric, co-editorial directors Études Ricœuriennes/Ricœur Studies Journal http://Ricoeur.pitt.edu
[1] Ricœur Paul. Éthique et politique. In: Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°5, 1985. pp. 58-70.
[2] David Utsler, Paul Ricœur and Environmental Philosophy, Rowman & Littlefield, 2024.
[3] Ricœur Paul. Éthique et politique. In: Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°5, 1985. pp. 58-70.
[4] David Utsler, Paul Ricœur and Environmental Philosophy, Rowman & Littlefield, 2024.
Read more about ERRS Appel à propositions / Call for papers - ERRS, Volume 16, n° 2 (2025) : « Les défis contemporains à l'épreuve de l'herméneutique critique : perspectives ricœuriennes / Contemporary Challenges Confronted by Critical Hermeneutics: Ricœurian Perspectives