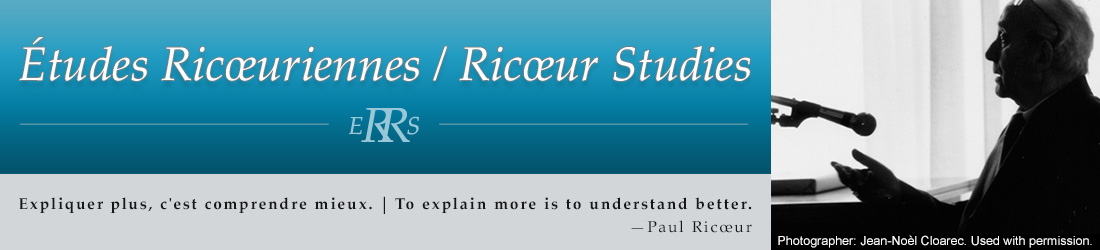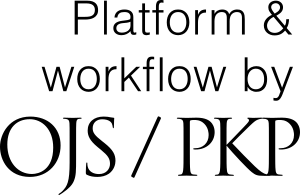APPEL A PROPOSITIONS / CALL FOR PAPERS
[English version follows below]
APPEL A PROPOSITIONS:
Études Ricœuriennes / Ricœur Studies (ERRS) - ERRS 17 n° 1, 2026 :
« RICŒUR À TRAVERS LE MONDE : RÉCEPTIONS ET DIALOGUES INTERCULTURELS »
« Je n’ai qu’un moyen de sortir de moi-même : c’est de me dépayser en autrui » (HV, p. 62).
Le genre de philosophie que Paul Ricœur défend s’ouvre vers l’extérieur ; de plus, certains aspects de son œuvre ne peuvent être achevés par l’auteur seul, fini et situé, et exigent d’être complétés par d’autres, finis aussi, mais situés autrement. Dans ce numéro spécial des Études Ricœuriennes / Ricœur Studies, nous proposons d’examiner (1) les modalités d’ouverture de la pensée ricœurienne, et (2) la manière dont ses lecteurs ont identifié des pistes de prolongement et de dépassement de son œuvre, ajoutant ce que Ricœur lui-même n’a pas pu nous proposer. Cette question a déjà fait l’objet de nombreuses analyses quant à la réception de son œuvre dans les traditions philosophiques occidentales et dans d’autres disciplines que la philosophie. Nous nous intéressons plus spécifiquement à la façon dont Ricœur « voyage » à travers le monde et à l’usage que ses lecteurs font de ses idées dans leurs contextes respectifs.
I. Une philosophie de l’ouverture et du dépaysement en autrui
Comme le suggère l’exergue, la philosophie de Ricœur établit des ponts et ouvre des chemins vers l’altérité. Allant dans le même sens, dans « La conviction et la critique » (Cahiers de l’Herne – Ricœur, p. 15), il préconise une approche philosophique sensible aux intersections et aux interférences plutôt qu’aux ruptures. Cette manière de philosopher rejette les synthèses prématurées de la vérité et les systèmes clos, et puise dans la tension des positions antagonistes l’énergie nécessaire pour tracer sa propre voie.
Ainsi, pour Ricœur, philosopher exige une conscience aiguë de la finitude du savoir et de l’impossibilité d’occuper tous les espaces de vérité. C’est adopter une sensibilité herméneutique qui reconnaît l’impossibilité d’un savoir absolu. Dès lors, la philosophie a une vocation d’écoute, de communication et d’accueil critique de la pensée des autres — non pas comme une fuite ou une négation de soi, mais comme une tâche de médiation réflexive et une quête de nouveaux horizons intellectuels. Le « dépaysement en autrui » constitue ainsi une caractéristique essentielle de la philosophie que Ricœur propose.
II. L’exigence politique et interculturelle
Cependant, il s’agit de bien plus que d’une simple question épistémologique. Les écrits sociopolitiques de Ricœur montrent que ce « style » de travail répond à sa compréhension des enjeux politiques contemporains. Dans « Civilisation universelle et cultures nationales », il s’interroge sur les conditions de possibilité des rencontres entre peuples de cultures différentes sans recourir à la domination ou à la conquête. Une herméneutique de la diversité culturelle de l’humanité et une réflexion sur les relations politiques asymétriques font partie de sa réponse à cette problématique. Que devient la pensée de Ricœur lorsqu’elle est reçue aux quatre coins du monde, là où l’autre n’est plus le « prochain » partageant le même horizon culturel, mais l’inattendu venu d’horizons étrangers : pensées indigènes, cultures autochtones, religions variées ou encore contextes sociaux et politiques différents ?
III. L’incomplétude thématique et interculturelle
Cette incomplétude, à la fois épistémologique et interculturelle, de la pensée ricœurienne a été relevée avec acuité par de nombreux lecteurs. D’une part, leurs appropriations créatives et critiques ont permis à l’œuvre ricœurienne d’être accueillie dans des domaines aussi divers que la littérature, la sociologie, la théologie, le droit, la psychologie, la communication, l’architecture, le féminisme, la politique de la mémoire, les technologies de l’information, ainsi que dans les débats sur le racisme, la violence, la démocratie, la décolonisation et les questions du genre. Nombre de pages desÉtudes Ricœuriennes / Ricoeur Studies ont en effet déjà été consacrées à plusieurs de ces thématiques.
D’autre part, Ricœur est aujourd’hui étudié sur tous les continents, à la lumière de situations historiques, sociales et politiques extrêmement variées. Doctorants et chercheurs confirmés ont contribué à l’étude de son œuvre non seulement en France et aux États-Unis, mais partout dans le monde. Plusieurs colloques internationaux ont été organisés pour stimuler cette réception : Stellenbosch (2018), Leuven (2020), Kinshasa (2022), Teresina (2025), pour n’en citer que quelques-uns récents.
Dans ces deux modalités, « compléter » l’œuvre de Ricœur revêt des formes multiples : de la fidélité exégétique et l’appropriation respectueuse de cet héritage stimulant, au débat critique où la pensée ricœurienne devient un élément parmi d’autres dans une constellation d’idées façonnée par les préoccupations des auteurs.
IV. Une réception mondiale et plurielle
Tous ces traits aident à expliquer l’extraordinaire réception de l’œuvre de Ricœur dans une diversité de cadres culturels et conceptuels. Le croisement des horizons culturels et conceptuels soulève des enjeux majeurs : identité narrative, mémoire, altérité, reconnaissance, mutualité, hospitalité linguistique, justice. Dans des contextes de subordination historique et de mémoires blessées en particulier, ces questions posent des défis imprévus à la politique d’identité et à la reconnaissance de soi, mais ouvrent aussi de riches perspectives de convergence interculturelle, exigeant de nouvelles médiations critiques pour une herméneutique du soi.
Le cadre de référence qui se dessine dans ces réceptions se caractérise par une polarité ambiguë. D’un côté, les cultures ne sont pas incommunicables. L’étranger demeure un « semblable » au sens d’une « équivalence sans adéquation » (Sur la traduction, p. 19) qui s’élève « au rang d’un pari et d’une affirmation volontaire de l’identité de l’homme » (Histoire et vérité, p. 336). De l’autre, une reconnaissance lucide des histoires de violence et d’oppression, ainsi que des dominations et des exploitations contemporaines, s’impose dans un monde où le capitalisme prédateur fabrique la pauvreté (« Que signifie la présence des pauvres parmi nous ? », 1961, p. 11) et où les relations internationales violentes du passé se perpétuent aujourd’hui par d’autre moyens.
Nous invitons les chercheurs souhaitant réfléchir dans ce champ de tension à proposer des contributions sur le thème : « Ricœur à travers le monde : réceptions et dialogues interculturels ». Leurs réflexions pourront notamment s’orienter vers les questions suivantes :
- Comment les écrits, l’enseignement et les pratiques scientifiques de Ricœur ont-ils facilité une réception aussi vaste ? Qu’y a-t-il dans sa pensée qui incite à cet accueil ? Qu’est-ce qui, dans cette pensée, peut faire obstacle à son appropriation ?
- Quelle place occupent les différents « mondes » dans sa pensée ? Quelles sont les possibilités et les difficultés de la traduction ? Quel degré d’innovation peut admettre la réception fidèle d’un patrimoine (innovatio / aemulatio) ?
- Comment l’œuvre de Ricœur a-t-elle été reçue dans d’autres régions du monde ? Comment les questions suscitées dans ces contextes contribuent-elles à une meilleure compréhension, élaboration ou critique de sa pensée ?
- Quelles questions épistémologiques et politiques doivent être envisagées pour la mémoire, la transmission et l’innovation des biens culturels, de l’art, des langues et des traditions ?
- Quels enjeux contemporains, à l’échelle mondiale, peuvent être éclairés par la réception des idées ricœuriennes ? Pensons à la justice globale, aux migrations, à la xénophobie, au racisme, à l’égalité de genre, à l’esclavage et aux autres formes d’exploitation.
- Comment la philosophie ricœurienne peut-elle nous aider à écouter et dialoguer avec d’autres traditions philosophiques non européennes ? Favoriser des échanges mutuellement éclairants ? Libérer la philosophie européenne de son enfermement eurocentrique ?
Nous accueillons avec intérêt toute contribution scientifique portant sur la philosophie de Ricœur, sa réception dans le monde et les propositions de dialogue avec d’autres philosophes et traditions.
Date limite de transmission des textes : 5 mars 2026.
Nombre de caractères max. (espaces compris, notes incluses) : 50 000 caractères.
Format et style: Les contributions doivent être rédigées en français ou en anglais. Format : pour les questions de style, le journal suit le Chicago Manual of Style. Voir sur le site de la Revue, la rubrique « Directives aux auteurs » : http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/about/submissions#onlineSubmissions. Les articles qui ne respecteront pas ces contraintes éditoriales ne seront pas examinés.
Format and style: pour soumettre un article, les auteurs doivent s’inscrire sur le site du Journal : http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/user/register. Les auteurs doivent suivre un parcours rapide (en cinq étapes) pour télécharger leur article sur le site. Dès réception, les auteurs reçoivent un e-mail de confirmation. Tous les articles sont soumis à une procédure d’évaluation dite à l’aveugle par des pairs.
Editeurs invités : Roberto Lauxen, Andrés Bruzzone et Ernst Wolff.
Jean-Luc Amalric et Ernst Wolff, co-éditeurs des Études Ricœuriennes / Ricoeur Studies, http://ricoeur.pitt.edu
CALL FOR PAPERS / APPEL A PROPOSITIONS :
Études Ricœuriennes / Ricœur Studies (ERRS) - ERRS 17 n° 1, 2026 :
« RICŒUR ACROSS THE WORLD: INTERCULTURAL RECEPTIONS AND DIALOGUES »
“I have only one way of getting out of myself: it is to disorient myself in others” (HT, p. 51, translation modified).
The kind of philosophy that Paul Ricœur advocates opens itself to an outside; moreover, certain aspects of his work cannot be completed by the author alone, finite and situated as he is, and require completion by others, who are also finite but differently situated. In this special issue of Études Ricœuriennes / Ricoeur Studies, we propose to examine (1) the modalities of openness of Ricœur's thought, and (2) the ways in which his readers have identified avenues for extending and transcending his work, adding what Ricœur himself was unable to offer us. This question has already been the subject of numerous analyses of the reception of his work in Western philosophical traditions and in disciplines other than philosophy. We are more specifically interested in how Ricœur “travels” across the world and how his readers use his ideas in their respective contexts.
I. A philosophy of openness and disorientation in others
As the epigraph suggests, Ricœur's philosophy builds bridges and opens paths to otherness. Along the same lines, in « La conviction et la critique » (Cahiers de l’Herne – Ricœur, 1), he advocates a philosophical approach that is sensitive to intersections and mutual influences rather than ruptures. This way of philosophizing rejects premature syntheses of truth and closed systems, drawing on the tension between opposing positions to find the energy needed to chart its own course.
Thus, for Ricœur, philosophizing requires an acute awareness of the finitude of knowledge and the impossibility of occupying all positions of truth. It means adopting a hermeneutic sensibility that recognizes the impossibility of absolute knowledge. From then on, philosophy has a vocation of listening, communicating, and critically welcoming the thoughts of others—not as an escape or a negation of oneself, but as a task of reflective mediation and a quest for new intellectual horizons. “Disorientation in others” is thus an essential characteristic of the philosophy that Ricœur proposes.
II. Political and intercultural demands
However, this is much more than a mere epistemological matter. Ricœur's sociopolitical writings show that this “style” of work reflects his understanding of contemporary political issues. In “Universal Civilization and National Cultures,” he reflects on the conditions that make it possible for peoples of different cultures to encounter each other without resorting to domination or conquest. His response to this issue includes a hermeneutics of humanity’s cultural diversity and a reflection on asymmetrical political relations. What becomes of Ricœur's thinking when it is received in the four corners of the world, where the other is no longer the “neighbor” sharing the same cultural horizon, but the unexpected stranger coming from foreign horizons: indigenous thoughts, local cultures, diverse religions, or different social and political contexts?
III. Thematic and intercultural incompleteness
This epistemological and intercultural incompleteness of Ricœur's thought has been keenly noted by many readers. On the one hand, their creative and critical appropriations have allowed Ricœur's work to be welcomed in fields as diverse as literature, sociology, theology, law, psychology, communication, architecture, feminism, the politics of memory, information technology, as well as in debates on racism, violence, democracy, decolonization, and gender issues. Many pages of Études Ricœuriennes / Ricoeur Studies have already been devoted to several of these themes.
On the other hand, Ricœur is now studied on every continent, in the light of extremely varied historical, social, and political situations. Doctoral students and established researchers have contributed to the study of his work not only in France and the United States, but throughout the world. Several international conferences have been organized to stimulate this reception: Stellenbosch (2018), Leuven (2020), Kinshasa (2022), Teresina (2025), to name but a few recent examples.
In both cases, “completing” Ricœur's work takes many forms: from exegetical fidelity and respectful appropriation of this stimulating legacy to critical debate in which Ricœur's thought becomes one element among others in a constellation of ideas shaped by the concerns of the authors.
IV. A global and pluralistic reception
All these features help explain the extraordinary reception of Ricœur's work in a variety of cultural and conceptual contexts. The intersection of cultural and conceptual horizons raises major issues: narrative identity, memory, otherness, recognition, mutuality, linguistic hospitality, justice. In contexts of historical subordination and wounded memories in particular, these questions pose unexpected challenges to identity politics and self-recognition, but also open up rich prospects for intercultural convergence, requiring new critical mediations for a hermeneutics of the self.
The frame of reference that emerges in these receptions is characterized by an ambiguous polarity. On the one hand, cultures are not incommunicable. The foreigner remains a “similar” in the sense of an “equivalence without adequacy” (On Translation, p. 7) that rises “to the level of a gamble and a voluntary affirmation of human identity” (HT, p. 282, translation modified). On the other hand, a lucid recognition of histories of violence and oppression, as well as contemporary domination and exploitation, is necessary in a world where predatory capitalism manufactures poverty (“What does the presence of the poor among us mean?”, 1961, p. 11) and where the violent international relations of the past are perpetuated today by other means.
We invite researchers wishing to reflect on this field of tension to submit contributions on the theme: “Ricœur across the world: intercultural receptions and dialogues.” Their reflections may focus on the following questions:
- How did Ricœur's writings, teaching, and scientific practices facilitate such widespread reception? What is it about his thinking that encourages this reception? What, in his thinking, might obstruct its reception?
- What place do different “worlds” occupy in his thinking? What are the possibilities and difficulties of translation? What degree of innovation can be accepted in the faithful reception of a heritage (innovatio/aemulatio)?
- How has Ricœur's work been received in other parts of the world? How do the questions raised in these contexts contribute to a better understanding, elaboration, or critique of his thought?
- What epistemological and political questions need to be considered for the memory, transmission, and innovation of cultural goods, art, languages, and traditions?
- What contemporary issues, on a global scale, can be elucidated by the reception of Ricœur's ideas? Consider global justice, migration, xenophobia, racism, gender equality, slavery, and other forms of exploitation.
- How can Ricœur's philosophy help us listen to and engage in dialogue with other non-European philosophical traditions? How can it promote mutually enlightening encounters? How can it liberate European philosophy from its Eurocentric confines?
We welcome any scholarly contributions on Ricœur's philosophy, its reception around the world, and proposals for dialogue with other philosophers and traditions.
Deadline for submission of articles: 5 March 2026.
Maximum number of characters (including spaces and notes): 50,000. Articles can be written either in English or in French.
Format and style: The journal follows the Chicago Manual of Style. See the rubric ‘Author Guidelines’ on the journal’s website:
http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/about/submissions#onlineSubmissions
The editors cannot consider articles that do not follow these guidelines.
Instructions to authors: In order to submit an article, authors need to register on the journal website: http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur/user/register. There is a quick, five-step procedure to upload articles to the website. As soon as articles are uploaded, authors will receive a confirmation email. All articles will be peer-reviewed by two referees in a ‘double blind’ process.
Guest editors: Roberto Lauxen, Andrés Bruzzone et Ernst Wolff.
Ernst Wolff and Jean-Luc Amalric, co-editors of the Études Ricœuriennes / Ricoeur Studies, http://ricoeur.pitt.edu